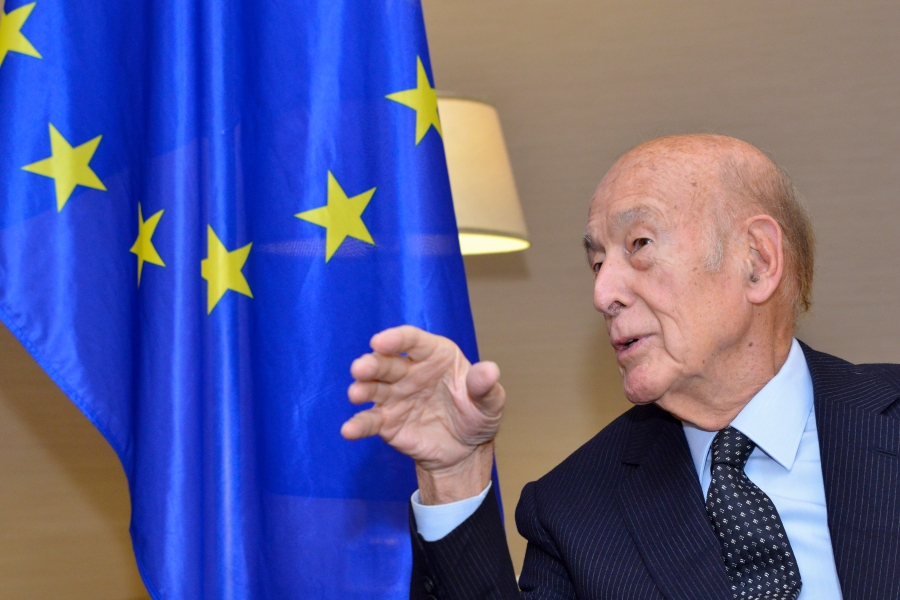Les 750 milliards d’euros censés aider l’Europe à se remettre de la crise du coronavirus pourraient avoir un profond impact sur le fonctionnement même de l’UE. Mais il faudra pour cela s’assurer que l’UE dispose des moyens adéquats pour transformer l’essai et envisager son avenir au-delà de la crise. Décryptage.
(l’article a été initialement publié le 29 juillet sur VoxEurop en version française. English version available here)
Historique ! Le mot a été repris en boucle par tous les promoteurs de l’accord obtenu par le Conseil européen sur le plan de relance le 21 juillet dernier, annoncé aux premières lueurs de l’aube, tout un symbole. Les contempteurs de l’accord n’ont pas tardé à se faire entendre en faisant savoir qu’il n’en était rien, en recouvrant bien vite tout ce rose brillant d’un noir mat et profond. Tous feignent d’ignorer que les décisions ressortant du Conseil requièrent davantage de nuance et de polychromie.
L’évaluation d’ensemble est un exercice délicat, c’est pourtant celle qui prévaut. Car elle sied mieux à la théâtralité européenne, d’autant plus vive que les spectateurs sont de plus en plus nombreux à regarder l’Europe improviser dans la tourmente. Chacun sait aussi qu’il faudra convaincre les opinions et les 42 parlements régionaux et nationaux de l’UE à 27 qui voteront ce plan. Alors autant marquer les esprits, et va pour historique.
Toutefois, la liste des qualificatifs de cette décision peut être enrichie selon ce qu’on évalue. En voici une liste possible.
Historique, donc
Le mot s’est imposé car de nombreux tabous “historiques” sont bel et bien tombés : 1. Endettement mutuel (vieille lune fédéraliste tenant lieu de cheval de Troie de l’Europe politique pour les tenants de l’Europe-marché) ; 2. Investissements publics massifs (la suspension du pacte de stabilité et de croissance avait annoncé la couleur) ; 3. Europe des transferts (avec des subventions pour l’Italie et l’Espagne en tête, les deux pays les plus touchés par l’épidémie qui étaient déjà malades avant et menaçaient l’équilibre du marché intérieur comme de la zone euro). Ces avancées sont assurément une excellente nouvelle autant qu’une surprise, d’autant que quelques jours seulement avant l’accord certains Etats parmi les “frugaux” (Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède, rejoints par la Finlande durant le Conseil) disaient encore ne pas vouloir entendre parler de dette mutualisée.
Proportionnée
La Commission prévoit que l’économie de l’UE devrait se contracter de plus de 7 % en 2020. Avec 750 milliards d’euros, 390 de subventions, et le reste sous forme de prêts, l’Europe répond massivement à la crise. Ce d’autant que 540 milliards d’euros de prêts ont déjà été mobilisés, que la BCE a racheté pour 2 000 milliards d’euros d’obligations, et qu’il faut aussi rajouter les plans nationaux de relance. Certes, la distribution des subventions a été revue à la baisse par rapport à la proposition initiale de 500 milliards, mais à dire vrai beaucoup s’y attendaient et s’accordaient en coulisse sur 400 milliards de fonds nécessaires (390 n’est qu’une concession symbolique). Seront-ils suffisants ? Difficile à dire encore, surtout si une deuxième vague épidémique venait compliquer encore les choses et frapper des Etats ne faisant pas partie des premiers bénéficiaires du plan. Mais un pari, fût-il sur l’avenir, comprend fatalement des risques.
Solidaire
La décision est bien sûr solidaire sur le plan financier puisqu’il y a endettement commun et transferts. Mais elle l’est aussi sur le plan de la gouvernance avec l’abandon du droit de veto sur le contrôle exercé sur les modalités des dépenses au profit d’une majorité qualifiée des Etats, n’en déplaise à Mark Rutte. Restera ensuite à voir si la solidarité exprimée par le plan constituera un précédent. Il ne s’agit pour l’heure que d’un plan circonstanciel, temporaire, qui aura épuisé ses fonds dans 3 ans, même s’il faudra les rembourser jusqu’en 2058. Rien ne permet de garantir à ce stade que le principe se fera pérenne et intégrera de futurs traités.
Allemande
Si les tabous sont tombés un à un, c’est autant à Berlin qu’à Bruxelles que cela est survenu. Jusqu’ici championne incontestée des frugaux, l’Allemagne avait tenu bon sur la rigueur, y compris durant la crise financière de 2008 puis la crise des dettes souveraines. Elle a pourtant fini par changer d’avis en l’espace de quelques semaines. Or sans elle, rien n’était possible. Le changement de cap est survenu sous la direction éclairée d’une chancelière arrivée à l’âge de songer à sa postérité, en état de grâce politique alors qu’elle est appuyée par un confortable consensus, et surtout soutenue par le patronat allemand qui s’inquiète de l’effet domino. Elle a saisi la gravité du moment, et pressenti aussi que la population la suivrait, à moins d’ailleurs que celle-ci ne l’ait précédée. La crise obligeait d’accéder enfin aux requêtes françaises longtemps restées sans réponse. Si La France proposait, il fallait attendre que l’Allemagne soit disposée à disposer. Le couple franco-allemand a ainsi une fois de plus montré sa force motrice, d’autant plus forte que la Commission a fait front avec lui.
Post-Brexit
Un autre pays a joué dans cette affaire, mais par son absence. La décision du Conseil est aussi la première décision majeure opérée à 27, sans le Royaume-Uni, l’empêcheur européen numéro un de mutualiser en rond. Les Pays-Bas ont beau avoir voulu reprendre le rôle, ils n’ont pas la même étoffe, et leur alliance frugale de circonstance n’a pas pu atteindre la masse critique suffisante pour faire pencher la balance de leur côté.
Intergouvernementale
En dépit de ce que prévoient les traités, le Conseil européen est plus que jamais l’endroit où se décide le futur de l’Europe au sommet des exécutifs. C’est la crise financière qui avait révélé ce biais institutionnel européen, que confirme le plan de relance alors que le Parlement reste sur la touche. Ce dernier demandait pourtant dans une résolution de mai 2020 un montant de 2 000 milliards pour un tel plan, il en sera pour ses frais… Reste à espérer que la Commission, à qui sera confiée la tâche de contrôler et d’orienter le plan selon des conditions qui restent encore d’ailleurs largement à être consolidées, trouvera le moyen d’assurer que les intérêts et les valeurs de l’Union prévalent sur les seuls intérêts nationaux. C’est essentiel. Mais rien n’est acquis. Le Parlement le sait, et le dit.
De trop courte vue
C’est l’inquiétude légitime qui ressort de la résolution que le Parlement européen vient de prendre consécutivement à l’accord. Elle exprime la colère des députés européennes de voir le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 se limiter à 1 074 milliards, soit peu ou prou le montant de la dernière proposition de la Commission. La proposition du Conseil est jugée largement insuffisante pour relever les défis européens d’autant que des coupes sévères ont été faites dans les politiques communautaires jugées d’avenir. Pour ne citer qu’elles, on trouve parmi les politiques affectées celles relatives à la santé, à la recherche, ou encore à la défense, ce qui interroge avec une Commission autoproclamée géopolitique qui caresse des espoirs de voir l’Europe se faire puissance. La pilule est amère à avaler comme le dit Ursula von der Leyen elle-même. La bataille interinstitutionnelle autour du CFP n’en est sans doute qu’à ses débuts, et gageons que le Parlement s’emploiera à obtenir des crédits supplémentaires et l’engagement d’une révision à mi-parcours, comme pour le précédent budget.
Pour la relance ou le rétablissement ?
On peut légitimement se demander si la stratégie qui consistait à lier dans la négociation le plan et le CFP était la meilleure. Cela garantissait certes d’arriver à une décision rapide dans un seul et même paquet, mais le risque était grand que cela ne se solde par un compromis peu ambitieux pour le CFP au regard des enjeux, suite à des jeux délétères de vases communicants entre les deux budgets. Il semblait en effet assez fatal que les Etats n’en viennent à miser le plus gros sur le plan, qui est à leur mesure intergouvernementale, quitte à passer par l’endettement commun pourvu que les dépenses soient nationales et s’effectuent dans une relative absence de contraintes. C’était la meilleure garantie à leurs yeux d’un rétablissement rapide de leur santé économique perdue, leur « recovery » en anglais. Mais ceci, s’est donc fait au détriment du CFP, alors que c’est pourtant lui l’instrument dont la fonction est de dessiner l’avenir de l’UE, en assurant élaboration et contrôle commun des politiques et des investissements des 27, dans une perspective de moyen terme, sur sept ans. C’est bien lui, qui est le plus à même de dégager un cadre pour la « relance » (le titre du plan en français). Les traductions sont toujours ardues en Europe, elles sont aussi significatives, et la version anglaise et française de ce plan n’ont pas fini d’entretenir le doute entre “recovery” et “relance”, dont les sens sont prétendument identiques. Le sont-ils ?
Ainsi, quelles sont les garanties que ce contrat à durée déterminée fraîchement signé entre les 27 ne profite vraiment à tous, se demandent les députés européens ? Comment être sûr que les Etats feront preuve de la vertu et de la compétence suffisantes pour résoudre leurs problèmes nationaux grâce aux subventions et aux prêts consentis en parvenant à anticiper les effets durables de leurs investissements pour les autres Européens, même si tout se fait sous le contrôle vigilant (et nécessaire) de la Commission en vertu de prétendues conditionnalités ? Comment donc assurer aux « prochaines générations », pour faire écho au nom officiel du plan baptisé “Next Generation EU”, que la relance sera tournée vers le futur et sera conforme aux priorités de l’Union, verte et numérique ?
Ces questions exigent en effet d’être posées. Et ce petit panorama des qualificatifs à associer aux décisions prises à ce Conseil extraordinaire permet donc de comprendre que si certains aspects de l’accord sont très encourageants, d’autres laissent plus perplexes.
Il faut lever les ambiguïtés, car c’est la portée historique à long terme de l’accord sur lequel vient de s’entendre le Conseil qui en dépend. Pour cela, il faudra considérer les trois questions suivantes, questions anciennes, auxquelles l’accord nous impose plus que jamais de répondre :
Comment continuer avec l’unanimité ?
Comment se satisfaire d’un mode de gouvernance hérité du passé faisant de l’unanimité une règle prégnante quand les décisions procèdent d’une solidarité et d’une interdépendance croissantes ? Où est la cohérence entre le fait de prendre des risques partagés et celui de laisser la possibilité à un seul pays de bloquer tous les autres ? L’unanimité n’est pas compatible avec la mutualisation des risques et des ressources. La conférence sur l’avenir de l’Europe devrait être a minima l’occasion de repenser la plomberie institutionnelle en proposant une réforme du système de vote au Conseil imposant le recours systématique à la majorité qualifiée.
Comment continuer sans ressources propres ?
Comment ouvrir la porte à une politique budgétaire européenne avec endettement mutuel sans pousser plus avant la logique en dotant l’UE de ressources propres pour abonder son budget au moyen d’une fiscalité européenne ad hoc ? L’accord les prévoit, il faut s’en féliciter, mais la taxe plastique ne sera pas suffisante, elle devrait tout juste couvrir le montant des nouveaux rabais concédés aux Etats. Le jeu est à somme nulle. Il faudra plus d’ambition là aussi, et s’engager sur un calendrier contraignant pour envisager de nouvelles taxes permettant de réduire significativement les contributions nationales et la logique fatale du juste retour qui y est associée. Si une politique budgétaire expansionniste aura besoin du soutien renforcé de la BCE pour monétiser les déficits publics et garder les Etats solvables au risque de possibles bulles notamment immobilières, ces déficits risquent de toute façon de s’alourdir. Le recours aux ressources propres permettrait de les alléger et de confirmer par la fiscalité européenne les priorités politiques de la relance européenne.
Comment continuer sans se demander comment dépenser avant d’emprunter ensemble ?
L’économiste Tito Boeri faisait remarquer dans un récent article que pour que l’Italie ne rate pas l’opportunité formidable que représente pour elle le plan de relance dont elle sera la première bénéficiaire avec 209 milliards d’euros, elle doit d’abord se demander comment dépenser avant de demander de l’argent. Il ajoutait que l’Italie avait hélas été la dernière à publier son plan national de réforme, un plan jugé “verbeux” qui n’a pas même encore été communiqué à Bruxelles… Le même flottement s’applique à l’UE dans son ensemble quand on voit la difficulté qu’elle a à prévoir et mettre en œuvre des projets industriels transnationaux concertés et concrets au-delà de la définition des montants des enveloppes supposés y être consacrées.
La relance dépendra pourtant de cette capacité à faire des projets d’avenir ensemble, seule façon d’engager durablement l’Europe sur le chemin de la transition écologique et numérique. Une récente note politique de l’OFCE posait également cette question du “comment dépenser” l’argent d’un plan de relance post-COVID, et avançait des pistes pour un programme d’investissement articulé autour de trois axes majeurs : santé publique, infrastructures de transport, et énergie décarbonée. Voilà des pistes. Il faut les multiplier, les idées comme les projets concrets manquent.
C’est sur la base des réponses à ces trois questions que l’accord entré dans l’histoire sur lequel se sont entendus les 27 contribuera à la changer. Il faut consolider l’intégration et les mécanismes d’action commune en appuyant sur les leviers de la gouvernance, de la fiscalité, et des stratégies et projets industriels transnationaux. En somme, l’accord doit ouvrir à des “réalisations concrètes”, pour reprendre un vocabulaire schumanien, et s’en donner les moyens pour produire des résultats tangibles et rapides que les Européens puissent constater au plus vite. C’est ainsi que notre Union sera en mesure de se préparer à l’avenir en pensant aux générations futures, comme cet accord nous y invite.